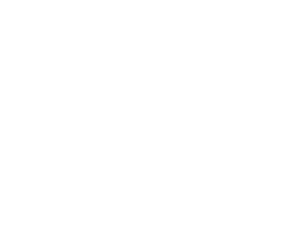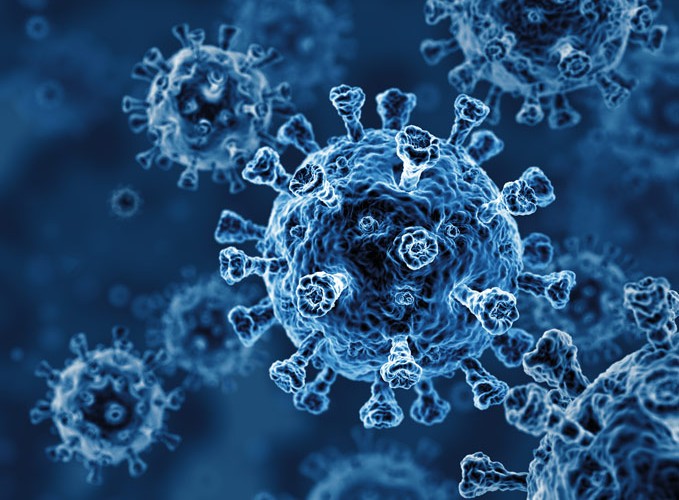Entretien avec un leader d’idées – Deb Chachra
mars 17, 2025
Bulletin trimestriel du Réseau canadien de l’eau (RCE) contenant les dernières nouvelles, des perspectives, et des réflexions de leaders d’opinion.

Nicola Crawhall, PDG du Réseau canadien de l’eau, s’est entretenu en profondeur avec Deb Chachra, conférencière de Blue Cities et auteure canadienne de How Infrastructure Works: Inside the Systems That Shape Our World.
Deb Chachra est professeure et spécialiste des matériaux à l’Olin College of Engineering du Massachusetts.
Que signifie l’expression « citoyenneté des infrastructures » ? Qu’entendez-vous par là ?
La citoyenneté des infrastructures fait référence à notre relation les uns avec les autres en vertu d’un réseau d’infrastructures partagé, qu’il s’agisse de transporter de l’eau, du gaz ou de l’électricité, indépendamment de l’affiliation politique. Lorsque nous investissons dans les infrastructures, c’est l’ensemble de la société qui en bénéficie, en établissant une relation entre les habitants de la ville, non seulement dans le présent, mais aussi pour les années ou les décennies, voire les siècles à venir. Nos réseaux d’infrastructures nous relient à la terre où nous vivons, aux personnes qui nous ont précédés et à l’avenir.
J’illustre généralement la citoyenneté des infrastructures en parlant de l’eau. Toute communauté où les gens vivent ensemble trouve le moyen d’obtenir de l’eau propre et de gérer les eaux usées. Nous construisons des systèmes qui apportent de l’eau propre là où nous vivons. Du point de vue de la santé publique, si les gens autour de vous n’ont pas d’eau propre, vous risquez de tomber malade. Tout le monde bénéficie d’un réseau d’approvisionnement en eau, car cela signifie qu’il y a moins de risques de tomber malade. Il est donc fortement souhaitable de veiller à ce que chacun ait accès à cette eau. Cet argument a prévalu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle pour justifier des investissements massifs dans des infrastructures publiques à l’échelle de la ville.
Vous considérez les infrastructures comme la manifestation physique de nos valeurs passées et futures d’équité et de répartition des avantages et des inconvénients.
C’est exact. Il y a la notion d’eau en tant que bien public, qui est dérivée de l’économie. Mais lorsque nous entendons ce terme, nous pensons normalement au bien au sens moral. L’Afrique du Sud, par exemple, a inscrit dans sa constitution que l’accès à l’eau est un droit humain. Et il est entendu de facto que c’est le cas partout. Lorsqu’on parle d’accessibilité ou d’équité, c’est le premier et le plus important point : ce ne sont pas des biens marchands. L’idée que quelqu’un puisse contrôler notre accès à l’eau comme dans un film de Mad Max… nous la reconnaissons immédiatement comme monstrueuse.
Un deuxième point est que l’histoire des réseaux d’infrastructure a largement consisté à trouver des moyens d’apporter des avantages aux personnes qui prennent les décisions concernant les infrastructures et à celles qui en bénéficient. Cela a généralement impliqué de trouver des moyens de faire face aux dommages associés aux infrastructures et à la circulation des ressources.
Les systèmes d’infrastructure sont très efficaces pour acheminer les ressources là où elles sont utilisées, mais la plupart d’entre eux sont également très efficaces pour extraire des ressources d’autres endroits ou déplacer les nuisances de ces systèmes vers d’autres endroits. L’électricité en est la meilleure illustration. Au XIXe siècle, la plupart de l’énergie était produite à proximité des lieux de vie, de sorte que les villes abritaient de lourdes centrales au charbon polluantes. Mais ces centrales ont été déplacées pour éloigner la pollution de la ville. Un autre aspect de ce préjudice, bien sûr, est que le charbon est extrait ailleurs, avec l’impact environnemental de cette extraction.
C’est ce que je veux dire quand je pense à la séparation spatiale des avantages et des inconvénients des infrastructures, avec les habitants de la ville qui construisent la centrale à charbon pour bénéficier de l’électricité et les inconvénients du déplacement de la pollution de la production d’énergie et les problèmes environnementaux liés à l’extraction. Il existe des schémas similaires avec d’autres réseaux d’infrastructure, donc si vous utilisez ce cadre, vous pouvez discerner la répartition de ceux qui en bénéficient et de ceux qui en souffrent. Jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, les dommages étaient déplacés par ceux qui construisaient les systèmes. Par exemple, les barrages d’Hydro-Québec dans le nord du Québec ont déplacé les peuples des Premières Nations de leurs terres traditionnelles.
Les réseaux de transport sont intéressants du point de vue de l’équité. Les autoroutes ont été construites à travers les villes américaines, généralement à travers les quartiers afro-américains. Ces autoroutes ont souvent été construites pour permettre aux gens de se rendre de la banlieue au centre-ville. Aux États-Unis, au milieu du XXe siècle, cela profitait surtout aux hommes blancs. Mais les personnes qui subissaient les conséquences de la proximité des autoroutes ou de la destruction de leur quartier par les autoroutes (ou simplement le bruit et la pollution) n’appartenaient généralement pas à ces groupes. Les avantages étaient inégalement répartis.
L’une des histoires du XXe siècle en ce qui concerne les infrastructures nord-américaines est le changement de la séparation spatiale des avantages et des inconvénients résultant de mouvements sociaux, comme le mouvement des droits civiques qui a donné à ceux qui étaient systématiquement lésés par les réseaux d’infrastructure une voix politique plus forte pour s’opposer à ces projets. Cela a changé notre façon de penser la construction des infrastructures. Soudain, grâce à l’activisme politique, cette façon typique de planifier qui bénéficierait et où les inconvénients se produiraient, n’était plus acceptée.
À Boston, l’autoroute I-90 traversait un quartier italien et l’I-95 traversait Chinatown. Puis, une autoroute devait être construite à travers un quartier historiquement afro-américain. Après avoir vu ce qui était arrivé à ces deux autres endroits, une coalition de protestations politiques s’est élevée contre le projet, ce qui a en fait entraîné une modification des lois fédérales pour soutenir les transports en général, et pas seulement les autoroutes. Là où l’autoroute initiale était proposée, il y a maintenant un corridor ferroviaire couvert qui est un parc linéaire.
Comment le changement climatique s’inscrit-il dans les questions d’équité, d’avantages et de préjudices ?
Il y a une vingtaine d’années, la majeure partie de notre énergie provenait de la combustion, c’est-à-dire de l’utilisation de combustibles fossiles. Nous en tirons individuellement des avantages. Mais les préjudices associés au CO2 présentdans l’atmosphère sont beaucoup plus diffus ; ils affectent tous les habitants de la planète, y compris ceux qui n’ont pas bénéficié de l’énergie utilisée. Dans ce cas, il s’agit moins de déplacer les dommages que de les diffuser à tout le monde. Politiquement, c’est un nouveau monde.
Nous passons maintenant d’une énergie provenant majoritairement de la combustion à une énergie provenant de sources entièrement renouvelables. Cette transition change réellement l’économie de l’énergie. Elle a le potentiel de changer radicalement l’économie du coût de l’atténuation des dommages. Les panneaux solaires installés sur les toits des maisons d’une ville sont généralement considérés comme ayant un impact négatif minime par rapport à une centrale électrique au charbon située au milieu de votre ville. De plus, l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables devient beaucoup moins chère. Changer l’économie de l’énergie change vraiment l’économie de ce qui est possible en termes d’atténuation des dommages. Il est ainsi plus facile de prendre des décisions différentes sur la façon dont vous allez construire des choses et atténuer les dommages.
Un bon exemple de cela est la fermeture des boucles de matériaux. Au lieu de rejeter de la pollution dans l’atmosphère, nous pouvons utiliser l’énergie renouvelable abondante et bon marché pour recycler ou réutiliser les matériaux, ou pour réduire ou éliminer l’extraction et les dommages qui y sont associés. C’est la prochaine étape en termes de réflexion sur les infrastructures et l’équité, et sur la manière dont elles sont liées à la durabilité et à la résilience.
Si nous sommes intégrés dans des réseaux d’infrastructures à travers nos paysages, qu’est-ce que cela signifie en termes de choix individuels pour réduire notre empreinte carbone ?
Pour décarboner ou réduire notre empreinte carbone individuelle, il faudrait utiliser beaucoup moins d’énergie si celle-ci est issue de combustibles fossiles. D’une manière générale, cela signifierait que nous ferions moins de choses ou les ferions différemment. Cependant, le problème ici est que la plupart de la consommation d’énergie n’est pas sous contrôle individuel. La plupart de nos émissions proviennent de systèmes partagés et la plupart d’entre nous n’avons pas beaucoup de choix individuel quant à la provenance de notre électricité. Nous utilisons l’énergie pour cuisiner, chauffer et refroidir nos maisons et pour nous déplacer. Si vous vivez dans un endroit qui n’est pas bien desservi par les transports en commun, votre seul choix de mobilité est la voiture. Il est donc difficile d’avoir un impact significatif sur votre empreinte carbone en tant qu’individu.
C’est pourquoi des entreprises comme British Petroleum (et d’autres) ont promu l’idée des empreintes carbone individuelles. Elles ont vraiment vendu l’idée qu’il s’agit de votre problème individuel et que vous devez trouver comment le résoudre. Mais ce n’est pas le cas. C’est un problème collectif, car il s’agit en réalité de nos systèmes partagés. Je ne dis pas que vous devriez vous absoudre de toute responsabilité en tant qu’individu, mais c’est fondamentalement le mauvais cadrage.
Il faut comprendre que la majeure partie de notre consommation d’énergie, et donc de notre consommation de combustibles fossiles, et donc de nos émissions, provient de ces systèmes collectifs. La question devient alors : « Que faisons-nous de nos systèmes collectifs et comment les gérons-nous ? » Nous devons développer des alternatives communes aux choses qui ne dépendent pas de décisions individuelles. C’est tout à fait faisable d’une manière qui n’était même pas envisageable il y a 20 ans.
Le changement climatique et la nécessité de décarboner nos réseaux d’infrastructures sont des facteurs de changement incontestables. À l’heure où le climat est instable, quels conseils donneriez-vous aux décideurs en matière d’infrastructures publiques sur la manière de construire des systèmes d’infrastructures transformateurs ?
Mon travail porte sur la manière dont les réseaux physiques acheminent les ressources à travers le paysage, qu’il s’agisse d’eau, de carburant, d’électricité ou d’informations. Avec le changement climatique, ce paysage évolue, de sorte que les réseaux que nous avons conçus et construits, quelle que soit la qualité de leur construction, risquent de ne plus fonctionner correctement. Par exemple, la ville d’Austin a dû ordonner la mise en place d’un traitement de l’eau après que des inondations ont entraîné des limons dans leur réservoir et dépassé la capacité de l’usine de traitement des eaux. Austin a construit de bonnes infrastructures publiques, mais n’a pas mis en place un système d’approvisionnement en eau capable de faire face à ce niveau d’inondation. Quel que soit le travail que nous avons accompli par le passé avec nos réseaux, cela ne signifie pas qu’ils sont adaptés au monde de l’instabilité climatique. Il en a été de même pour l’ouragan Sandy à New York et les incendies de forêt à Los Angeles.
Comme notre paysage n’est plus stable, les réseaux qui y sont intégrés doivent être repensés. On ne peut pas se contenter de dire : « Eh bien, tout ira bien ». Les lieux seront tous affectés différemment, mais ils le seront, que ce soit par la pénurie d’eau ou par l’eau au mauvais moment en raison de la fonte précoce des neiges ou des inondations. Si vous avez construit des paysages imperméables, vous ne pouvez pas capter cette eau – elle est perdue et vous n’y avez pas accès. (Mexico en est un bon exemple.) Vous ne pouvez pas simplement ignorer le changement climatique et vous dire : « Notre système est bon ». Vos systèmes ne seront probablement pas assez bons.
En ce qui concerne les mesures à prendre, il y a cet élément de décarbonisation « global ». La raison morale de le faire est de réduire le dioxyde de carbone dans l’atmosphère et de ralentir le changement climatique. La raison réelle de le faire est qu’à moyen et long terme, il sera moins coûteux de payer pour les énergies renouvelables plutôt que pour les combustibles fossiles pour la distribution et les opérations, quoi qu’on en dise.
Cela nous ramène à l’idée de la citoyenneté des infrastructures. Tant que les humains existeront et vivront à proximité les uns des autres, ils auront besoin d’eau. Nous devons penser et planifier les infrastructures à perpétuité. L’autre élément nous ramène à la raison pour laquelle nous avons construit ces systèmes en premier lieu : nous comprenons qu’investir dans ces systèmes entraînera des retombées à la fois monétaires et non monétaires. On investit pour que les gens soient plus heureux et en meilleure santé, pour qu’ils n’attrapent pas le choléra. La santé est un bien intrinsèque, et les personnes qui ne contractent pas le choléra peuvent participer pleinement à l’économie. La logique a toujours été que nous investissons dans les infrastructures parce qu’elles sont le fondement de la réussite économique de l’endroit où nous vivons.
La raison pour laquelle les infrastructures soutiennent la réussite économique est qu’elles soutiennent la capacité et la volonté des gens à participer pleinement à la vie économique, au lieu de passer leurs journées à essayer de satisfaire leurs besoins fondamentaux. La véritable raison d’adapter vos systèmes d’infrastructure au changement climatique, d’investir dans la résilience, est la même que celle pour laquelle nous avons construit ces systèmes au départ. C’est le meilleur investissement que nous puissions faire pour la réussite de l’endroit où nous vivons. Investir dans les infrastructures essentielles, c’est investir dans les personnes qui y vivent et dans tout ce qui en découle.
Si nous construisons des infrastructures comme nous le faisions il y a 100 ou 150 ans, il n’y aura plus d’infrastructures fonctionnelles à l’avenir. Nous devons construire des infrastructures fonctionnelles, résilientes, durables et équitables. Ces objectifs sont liés. Il sera très difficile d’atteindre l’un de ces objectifs sans investir dans les quatre.
Pouvez-vous expliquer la relation entre la citoyenneté des infrastructures et l’éthique du soin ?
L’éthique du soin est une idée philosophique. La plupart des infrastructures sont implicitement utilitaires et sont régies par l’argent. Vous voulez que les avantages l’emportent sur les inconvénients à un coût raisonnable. Mais la question de savoir qui en profite, qui en pâtit, ce que signifie l’expression « l’emporter sur », et ce qu’est un coût raisonnable, a toujours été posée. Comment évaluer en dollars l’accès à l’électricité ou à l’eau potable ? Le problème de cette approche utilitariste implicite est qu’elle dépend vraiment de qui prend les décisions et de ce qu’elles sont. En revanche, l’éthique du soin est une philosophie et une approche qui ne se concentre pas uniquement sur qui profite et qui subit des dommages, mais sur l’idée que nous sommes en relation les uns avec les autres et que les décisions sont prises dans le souci de prendre soin les uns des autres. Carol Gilligan a écrit à ce sujet.
L’avantage de ce cadre est qu’il nous permet de nous concentrer sur des questions telles que qui sont les parties prenantes et qui est le plus vulnérable. Il s’agit de déterminer quels sont les impacts. Il s’agit d’être compétent pour fournir des soins. Il s’agit de comprendre ce dont les gens ont besoin. C’est amusant de parler d’éthique des soins aux personnes qui travaillent dans le domaine de l’eau, car vous utilisez déjà implicitement ce modèle pour la mise en place de systèmes d’infrastructure.
Malgré l’instabilité climatique qui rend nos systèmes d’infrastructure moins efficaces, vous êtes plutôt optimiste quant à l’avenir. Pourquoi ?
Je suis optimiste parce que nous pouvons désormais obtenir de l’énergie à l’échelle dont nous avons besoin sans passer par la combustion. Certaines régions du Canada ont une grande longueur d’avance dans ce domaine grâce à l’hydroélectricité. Si toute l’énergie a la même économie que l’hydroélectricité, cela ouvre un champ de nouvelles possibilités pour une énergie abondante, bon marché et renouvelable, tout en bouclant la boucle des matériaux. Ce cadre de transition énergétique et matérielle, en particulier pour les personnes qui participent à la mise en place de systèmes d’infrastructure, leur donne une façon de penser le travail qu’elles font. Et pour ceux d’entre nous qui ne sont pas directement impliqués, c’est une façon de penser et de parler de ce que nous voulons et attendons de ces systèmes.
La principale chose que je dis à mes étudiants en ingénierie, c’est que maintenant, nous savons comment faire. Nous avons les moyens d’un avenir décarboné grâce à des énergies renouvelables bon marché et abondantes comme l’éolien, le solaire, la géothermie et l’hydroélectricité – une voie vers un avenir où l’énergie est le bien public décentralisé et distribué qu’elle est, plutôt que de devoir passer par la combustion. Nous n’avons pas encore compris ce que signifie avoir une énergie véritablement abondante. Et quand je dis abondante, je veux dire ce qui arrive sur la planète chaque jour ; je regarde par la fenêtre par une journée ensoleillée, et c’est juste là.
Nous pouvons en fait mettre cette énergie à profit pour résoudre l’autre problème de l’extraction et de la consommation des matériaux. Tous ces atomes issus de matériaux et de processus usagés doivent aller quelque part, et beaucoup d’entre eux finissent au mauvais endroit, comme le dioxyde de carbone qui se déplace dans l’atmosphère au lieu de rester sous terre, ou les microplastiques dans les océans. Si nous avons accès à une énergie qui se comporte essentiellement comme la lumière du soleil, cela ouvre un champ de nouvelles possibilités pour faire face à ce type de dégradation de l’environnement.
Je dis à mes étudiants que leur travail ne consiste pas à limiter les méfaits du changement climatique ou à gérer tout ce qui va mal. Leur travail consiste en fait à construire cet avenir résilient, durable, équitable et fonctionnel, en exploitant les énergies renouvelables et en réfléchissant à la manière de traiter les questions relatives aux atomes. Il nous est possible de construire un monde où chacun a accès à l’autonomie rendue possible par l’énergie, où nous commençons véritablement et, espérons-le, faisons des progrès significatifs dans la lutte contre les dommages environnementaux résultant de la pollution. Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que pour ceux qui travaillent déjà dans le domaine des infrastructures, les choses que vous faites au quotidien peuvent contribuer à ce travail de transformation.
~
Merci, Deb, d’avoir partagé tes réflexions avec notre réseau. Pour en savoir plus sur les stratégies et solutions en matière de systèmes d’infrastructure avec le Dr Chachra et d’autres experts de premier plan, inscrivez-vous à Blue Cities les 14 et 15 mai à Mississauga.