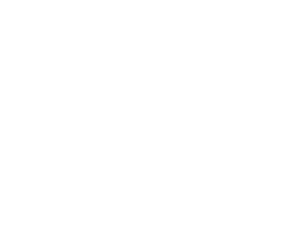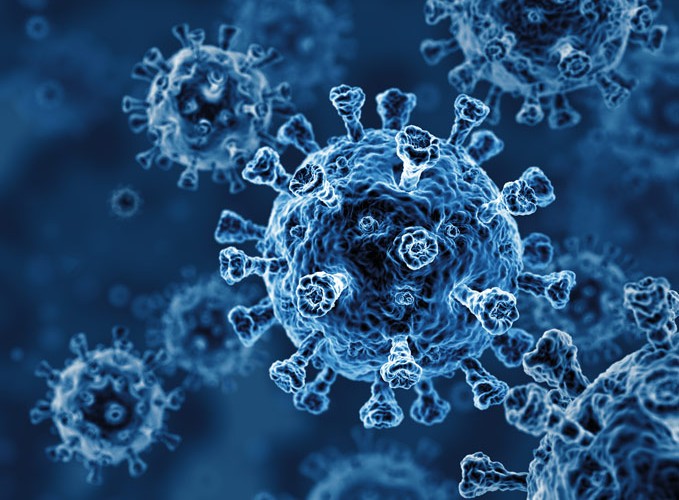Entretien avec le Dr. Maite Maldonado, leader d’opinion dans le domaine de la gestion des entreprises

Les microplastiques sont omniprésents dans notre vie et dans l’environnement. Le Canada négocie actuellement un accord international sur la pollution par les plastiques et a rejoint d’autres pays en interdisant certains plastiques à usage unique. Malgré l’ampleur du problème, la compréhension de la manière dont les microplastiques circulent dans l’environnement et dans notre corps n’en est qu’à ses débuts.
Nicola Crawhall, directrice générale du RCE, s’est entretenue avec le professeur Maria (Maite) Maldonado. Elle est l’une des principales chercheuses du groupe de recherche Microplastics, Health and the Environment de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et professeur au département des sciences de la terre, des océans et de l’atmosphère. Nicola a également rencontré la professeure associée Maria Holuszko du Norman Keevil Institute of Mining Engineering, la professeure adjointe Sepideh Pakpour de l’école d’ingénierie et la professeure adjointe Sara Beck du département de génie civil. Elles discutent de leurs recherches sur la source, le devenir, le traitement et l’exposition de la santé humaine aux petites particules de plastique, également connues sous le nom de microplastiques.
Qu’est-ce que le groupe de recherche de l’UBC sur les microplastiques, la santé et l’environnement ?
Maite Maldonado (MM) : L’UBC MSE est un groupe de recherche interdisciplinaire auquel participent 28 chercheurs issus de diverses facultés de l’UBC, notamment les sciences pharmaceutiques, l’ingénierie (biologique, civile et mécanique), les sciences (océanographie, chimie, botanique, biologie et santé publique) et les sciences sociales (sciences politiques, sciences du comportement, etc.). Ce groupe cherche à soutenir le développement de politiques éclairées concernant la pollution microplastique en comblant les lacunes fondamentales en matière de connaissances sur les microplastiques. Par exemple, nous visons à améliorer les méthodes d’échantillonnage et de traitement des microplastiques dans l’environnement (c’est-à-dire dans les effluents des stations d’épuration, les eaux pluviales, les sols agricoles, les sédiments marins, la colonne d’eau des océans, etc.) ). Cela nous permettra de normaliser les méthodes d’échantillonnage, de quantification et de caractérisation des microplastiques dans l’environnement. Nous visons également à déterminer les voies d’exposition humaine aux microplastiques, ainsi que les effets des microplastiques sur la santé humaine et l’environnement.
Pouvez-vous me parler de vos recherches sur les sources de microplastiques dans le détroit de Géorgie ?
MM : Comme d’autres pays, nous constatons que certaines des sources initiales de microplastiques sont les fibres synthétiques et les pneus, entre autres sources industrielles, commerciales et de vente au détail. Ils se décomposent et se répandent dans les eaux de lavage, sur les routes, dans les océans et dans les sols. Mais il est important de comprendre non seulement leurs sources, mais aussi leur devenir une fois qu’ils se sont décomposés. Tout comme les autres micropolluants, les microplastiques circulent dans l’environnement, de la source à l’eau, à la terre et à l’air.
MM : Au cours des quatre dernières années, six membres de l’UBC MHE ont travaillé ensemble sur un projet de recherche majeur visant à suivre et à modéliser les microplastiques qui se retrouvent dans le détroit de Géorgie, au large de la côte de Vancouver. Comme il s’agit d’un bassin abrité dont la circulation est bien connue, il constitue un excellent modèle pour retracer les sources de microplastiques provenant des eaux pluviales, des eaux usées et, bien en amont, des affluents tels que le fleuve Fraser. Nous recueillons des données depuis plusieurs années et construisons en même temps un modèle dans lequel les données seront saisies pour nous fournir une carte complète des sources, du cycle et du devenir des microplastiques dans la région métropolitaine de Vancouver.
Que savons-nous de l’exposition humaine aux microplastiques ?
MM : Nous connaissons l’exposition par ingestion depuis un certain temps. Une étude réalisée en 2019 par l’université de Newcastle pour le compte du World Wildlife Fund a établi qu’une personne moyenne pouvait ingérer cinq grammes de plastique par semaine, ce qui équivaut à manger une carte de crédit.
Sepideh Pakpour (SP) : C’est vrai, nous ingérons tous du plastique lorsque nous buvons de l’eau dans une bouteille en plastique (2 450 particules microplastiques (MPP)/jour) ou lorsque nous buvons chaque jour plusieurs tasses de thé infusé dans des sachets en nylon (29,4 milliards de MPP/jour). Nous respirons même des microplastiques en suspension dans l’air (en moyenne 130 MPP/jour).
SP : Une fois que ces très petites particules microplastiques (PM 10- PM 2,5 microns) sont dans notre corps, elles peuvent s’accumuler dans divers organes, notamment les poumons, le cœur et même le placenta. En ce qui concerne celles qui atteignent nos organes, il n’y a pas encore de consensus sur leurs effets sur la santé. Nous ne disposons tout simplement pas de suffisamment de données pour établir une quelconque relation de cause à effet.
SP : Mon équipe, en collaboration avec le Dr Julien Gibon, a étudié l’impact des microplastiques sur la santé du cerveau. Nous avons d’abord utilisé des souris comme substituts de cerveaux humains et découvert des particules qui avaient migré dans leur cerveau. Notre question de recherche actuelle est de savoir si les microplastiques peuvent s’attacher aux neurones et y pénétrer. Cette question se pose parce que nos études in vitro ont montré que six particules microplastiques attachées à des neurones humains peuvent induire un stress oxydatif, une cytotoxicité et une neurodégénérescence dans les neurones humains, les neurones corticaux étant plus sensibles que les nocicepteurs. En outre, nous avons examiné le rôle des biofilms sur les microplastiques et les nanoplastiques (MNP), démontrant que les MNP peuvent servir de véhicule à des biofilms pathogènes qui exacerbent de manière significative ces effets neurotoxiques.
Pouvez-vous me parler des recherches entreprises sur le traitement et l’élimination des microplastiques dans les eaux usées ?
MM : La bonne nouvelle, c’est que le traitement secondaire dans les stations d’épuration des eaux usées (STEP) a un niveau très élevé d’élimination des microplastiques. Une étude a montré que 70 % des microplastiques entrant dans l’une des principales stations d’épuration de Vancouver sont des microfibres et que le traitement retient environ 98 % de ces microplastiques. Les recherches que nous menons actuellement en collaboration avec les deux stations d’épuration de Metro Vancouver dotées d’un traitement secondaire, celles de Iona Island et d’Annacis Island, visent à déterminer les apports annuels de microplastiques dans l’environnement en prélevant des échantillons de microplastiques dans les effluents toutes les quatre heures pendant une année entière. Nous publierons nos conclusions à ce sujet l’année prochaine.
Maria Holuszko (MH) : Cependant, même si nous trouvons des moyens de capturer 100 % des microplastiques des eaux usées par le biais du traitement, nous nous retrouvons toujours avec une quantité importante de microplastiques dans les boues. Les recherches montrent que les biosolides provenant des eaux usées utilisées comme engrais sur les terres agricoles peuvent contenir une certaine concentration de microplastiques. Les particules de microplastiques peuvent donc s’accumuler dans le sol, puis s’écouler dans les cours d’eau ou être entraînées dans l’atmosphère lorsque le sol sèche, et être transportées par l’air. Cela contribue à la pollution microplastique dans les océans et ailleurs.
MH : J’ai recherché des procédés plus efficaces pour traiter les boues ou les biosolides afin d’en extraire les microplastiques. C’est là que nous pouvons tirer des enseignements du secteur du traitement des minerais. Il existe des parallèles dans les technologies de séparation et leurs avancées dans le traitement des minerais, telles que la séparation par gravité, la flottation par mousse et les clarificateurs, qui peuvent également être utilisées pour améliorer la récupération des plastiques et des microplastiques dans les stations d’épuration.
Sara Beck (SB) : Nous menons également des recherches sur des approches innovantes de la dégradation des microplastiques par la rupture des liaisons à l’aide de lumière solaire simulée, de lumière ultraviolette et de diodes électroluminescentes. La recherche déterminera dans quelle mesure les processus photochimiques dégradent les microplastiques et quelles sont les meilleures longueurs d’onde. Ces recherches sont actuellement menées à l’échelle du laboratoire.
Quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour réduire les microplastiques dans l’environnement ?
MM/SB : Il faudra un effort combiné, de la part des fabricants qui éliminent les microplastiques à la source, des régulateurs qui fixent des limites, des innovations dans les systèmes industriels et publics de traitement de l’eau, jusqu’aux choix des consommateurs individuels qui ne boivent pas d’eau dans des bouteilles en plastique et n’utilisent pas de produits en plastique.
MM : Il existe des solutions simples qui peuvent avoir un impact important. Par exemple, les gouvernements peuvent exiger des fabricants de machines à laver qu’ils installent des filtres pour capturer les microplastiques et empêcher qu’ils ne pénètrent dans nos cours d’eau. En ce qui concerne les particules d’usure des pneus, qui font partie des microplastiques les plus abondants et peuvent provoquer une toxicité aiguë chez les organismes aquatiques, nous avons également besoin d’approches pour empêcher leur introduction dans les eaux de surface. L’amélioration du balayage des rues et de sa fréquence permettrait de réduire les apports de microplastiques issus de l’usure des pneus dans les écosystèmes aquatiques. Notre collègue, la professeure adjointe Rachel Scholes, a effectué des recherches sur les infrastructures vertes adjacentes aux routes qui peuvent être utilisées pour capturer les particules d’usure des pneus dans les eaux de ruissellement des routes.
MM : Grâce à notre collaboration avec OceanWise, nous avons également appris que l’industrie des vêtements de sport s’intéressait beaucoup à la recherche sur l’écotoxicité des tissus microplastiques. Ils reconnaissent que les fibres naturelles seront très demandées à mesure que les consommateurs prendront conscience de l’impact des tissus synthétiques.
MM : Des recherches sont également menées sur les plastiques biodégradables. Nous ne pouvons pas interdire tous les plastiques. Nous avons besoin des plastiques, mais il existe des alternatives. Des bio-plastiques qui se dégradent complètement et ne nuisent pas à l’environnement sont en cours de développement.
Qu’avez-vous le plus apprécié dans votre participation au cluster microplastiques de l’UBC et quelles sont les prochaines étapes ?
MM : C’est la nature multidisciplinaire de la recherche et l’apprentissage auprès d’experts internationaux que nous avons fait venir. Je n’aurais jamais imaginé travailler avec des collègues aux perspectives aussi diverses que la chimie, l’ingénierie, la biologie et les sciences sociales.
MM : En ce qui concerne les prochaines étapes, le financement du cluster arrive à son terme, mais la recherche interdisciplinaire qui a été forgée au cours des trois dernières années se poursuivra. Un ensemble de travaux de recherche sera publié au cours des deux prochaines années. Ces publications seront disponibles sur le site web du cluster.
Y a-t-il des informations supplémentaires que vous souhaiteriez communiquer à notre public ?
MH : La contamination plastique des océans et des sources d’eau douce a fait l’objet de nombreuses études. Cependant, la pollution par les microplastiques, due à la dégradation des plastiques de grande taille en microplastiques de moins de 5 mm, dans les sols urbains et agricoles devient également un domaine de recherche important. Nos travaux récents sur la contamination par le plastique et les microplastiques ont également révélé des traces significatives de polyéthylène basse densité, de polyéthylène et de polypropylène dans le sol des jardins.